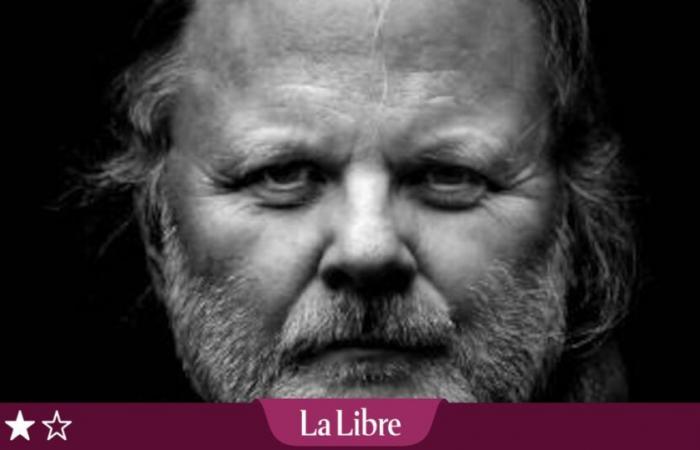Cette troisième partie continue de brouiller les marques de temporalité et d’identité. Asle, le peintre solitaire dont le flux de conscience est suivi, est envahi par des réminiscences où le passé et le présent se confondent, où chaque personnage est un miroir de lui-même ou d’un autre. Le souvenir de sa femme décédée Ales et de leur réunion frotte les épaules avec la préoccupation de la déchéance alcoolique de son ami Asle – le même nom, même profession, destiné à différent. De même, le souvenir de leurs débuts en tant que peintres fait référence à la question de son désir de créer, tandis que ses peintures sont bien vendues maintenant.
Une quête de absolu
À l’heure actuelle, ASLE se prépare pour une veille du Nouvel An en compagnie de son voisin voisin, Asleik. Aussi mince peut sembler cette intrigue, le texte s’épaissit progressivement par le va-et-vient de la mémoire et de la contemplation, jusqu’à cette soirée de Noël très symbolique.
S’il ne touche pas les sommets de la grâce du deuxième volume, il atteint à des endroits une puissance tourbillonnante qui peut rappeler Faulkner – mais sous les airs de Beckett, comme le style apparaît paradoxalement très raffiné, une «prose lente» comme l’appelle Jon Fosse.
La critique de «I est une autre», deuxième volume de septembre
Amour et mort, doute et absolu, foi et chute. La vie ainsi réduite à ses grandes questions peut sembler loin de la vie quotidienne, mais c’est dans la banalité des gestes d’Asle, dans la simplicité de ses mots, que sa méditation est ancrée.
Cependant, le narrateur se méfie du langage, car «Ces pensées ne sont probablement que des mots, et les mots mentent tout le temps, et je ne crois pas aux mots, jamais, et je ne crois aucune des pensées que je formule en mots, je pense, et je pense que ce n’est que dans mes images, quand je peins bien, que, oui, quelque chose peut être dit».
Ensuite, la clarté et l’obscurité s’entrelacent et se forment dans ses images d’esprit qu’il est précisément pour le peintre de «décoller» sur la toile, comme pour les exorciser, trouver par son art une «lumière obscure», évidence en silence, l’invisible dans le visible.
C’est dans ce sens très personnel qui converge, dans le livre comme dans la vie de Jon Fosse qui s’est converti tard au catholicisme, à la foi et à la création artistique. La force de ça Septologie réside dans la portée et la liberté de cette quête. Et en ce sens qu’elle réussit à la rendre sensible à tout le monde, pieuse ou incrédule, et à lire même sa prose une expérience spirituelle.
⇒ Un nouveau nom. Septologie vi-vii | Roman | Jon Fosse, traduit du néo-norwegian par Jean-Baptiste Coursaud | Bourgois, 250 pp., 21 €, numérique 16 € €