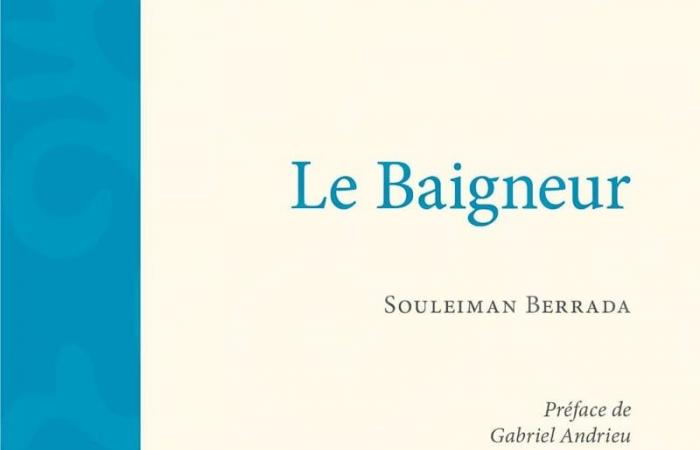À seulement 24 ans, le jeune écrivain marocain Souleiman Berrad marque une entrée remarquable sur la scène littéraire française avec Le Baignleur, publiée en France parmi les éditions Le Sigrail. Un premier roman de sensibilité inquiétante, où la sensualité, la mémoire et la réflexion se rencontrent autour du corps, du genre et de l’intimité se rencontrent dans un univers qui est à la fois concret et fantasmé: le hammam.
Né en 2001 à Tanger, Barada détient une licence dans la littérature française. Sa première expérience artistique a été sur les planches, à 16 ans, avec la troupe franco-marocaine la comédie de tangier fondée par Philippe Laurent. En 2022, il a été nommé secrétaire général de la Fondation pour la photographie de Tanger. Passionnée par les arts visuels autant que par les mots, Berrada tire d’une imagination hybride, nourrie par la tradition, l’introspection et une esthétique orientale supposée.
Sur les traces d’Ahmed Sefrioui, l’âme Berrada est ancrée dans un lieu emblématique de la vie quotidienne de Maghreb: le Hammam, dont l’auteur explore la charge poétique, érotique et sociologique. À Fès, une ville palimpest de l’histoire du Maroc, un jeune narrateur passe par ce moment suspendu entre l’enfance et l’adolescence. Le roman devient alors un récit d’éveil et de fresques sensorielles où les jeux de lumière, les murmures, les parfums du savon noir et la fluidité des corps deviennent tant de vecteurs de désir et de questionnement intérieur.

Le protagoniste, fasciné par la silhouette d’un jeune garçon, Ismaïl, découvre les frissons d’un trouble émergent. Ce changement dans le regard, loin d’être trivial, est restauré avec une délicatesse rare, dans une prose parfois lyrique, parfois introspective, où les sensations ont priorité sur l’intrigue. “” Cette double violation de l’intimité a nourri ma curiosité et mon désir Dit-il.
Intitulé Hommage aux toiles de Jean-Léon Gérôme et d’Ingres, le Bather invoque toute une imagination orientaliste picturale, mais sans pastiche ni appropriation. Loin de se soumettre aux clichés, Berrada réinvestit ces images à la lumière de sa propre expérience. Il évoque également l’influence de peintres comme Jacques Azéma et le photographe Pascal Meunier, dont les clichés des hammams orientaux l’ont profondément éminé. En mélangeant la mémoire personnelle et le patrimoine visuel, l’auteur produit un geste littéraire d’une densité rare.
À la question de savoir si le nageur ouvre un nouveau domaine de réflexion dans la littérature marocaine de l’expression française sur le corps et le genre, l’auteur répond avec la modestie: « Je ne me considère pas comme un écrivain militant. Ce qui me guide, c’est le désir de dire, de bouger, de déranger peut-être ». Et pourtant, par sa capacité à nommer l’inexprimable, à vous immerger dans les ambiguïtés du désir des adolescents, Berrada rompt avec les codes convenus de l’histoire de la formation de Maghreb. Il respire dans son texte une profondeur philosophique et une sensorielle rare, sans jamais payer en provocation gratuite.
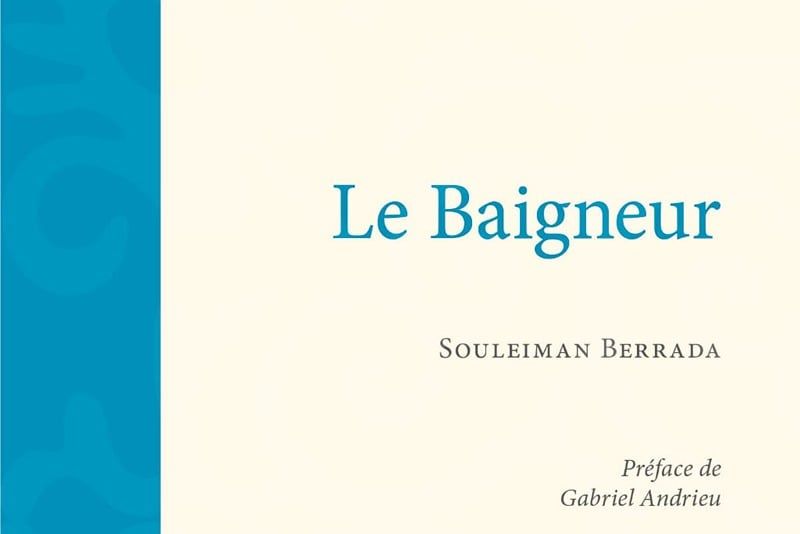
La préface a signé Gabriel Andriel en souligne avec précision: » Berrada ose parler de désir et représenter la beauté des corps sans crainte de vulgarité, dans la plus belle tradition de la littérature érotique ». Il parvient ainsi à hisser le roman à un niveau où l’intime devient politique, sans dogme mais avec une sincérité désarmante.
Preuve de la reconnaissance rapide qu’il suscite, le nageur a été présenté en avril 2025 à la foire du livre de Paris, où Souleiman Berrada était le plus jeune membre de la délégation marocaine. Une première apparition prometteuse dans les médias pour un auteur dont le stylo, de ce premier opus, révèle une maturité littéraire impressionnante.

Berrada évoque le hammam comme un endroit » gynec «, Où l’enfant garçon est présenté par sa mère dans un monde féminin jusqu’à ce qu’il soit symboliquement expulsé. Ce passage de seuil, vécu, examiné, internalisé, devient la matière même du roman. Il y a une forme de tendresse primitive, presque utopique, un espace où les corps peuvent toucher sans méfiance, où les adultes rejouent une partie de leur enfance.